Publié le 16/12/2024

Un article issue de la revue n°55 “Jeunes en mouvement”
Photo :Ufoops / Pexels
Une Interview d’Adrien Delespierre
Adrien Delespierre est sociologue et maître de conférences à l'université de Tours. Il a notamment travaillé sur l'internationalisation des grandes écoles d'ingénieurs.
Adrien Delespierre : Effectivement, certaines populations perçues comme immobiles, comme celles des zones rurales, peuvent parcourir en réalité de longues distances pour travailler. Ce qui différencie les classes sociales n'est pas tant la mobilité physique que les opportunités qu'elle offre. Ce n'est pas le fait de bouger qui compte, mais où l'on va, avec quelles ressources et pour quels profits.
Par exemple, les anciens élèves des grandes écoles lorsqu'ils partent à l'étranger, évoluent souvent dans des cercles fermés et des groupes sociaux très homogènes.
Peut-on encore parler de mobilité internationale selon votre sens, lorsqu'un « expatrié » travaille dans une banque française bien établie à Londres, à deux heures de train de Paris, où il côtoiera beaucoup d'autres Français sortis du même type d'école que lui. Leur mobilité est bien une stratégie de valorisation de leur capital, mais elle ne les confronte pas véritablement à d'autres mondes sociaux que ceux qu'ils connaissent déjà.
Il existe une forte inégalité dans l'accès aux types de mobilité valorisés. Une mobilité choisie, telle qu'un séjour dans une grande université étrangère ou une expérience professionnelle prestigieuse à l'international, s'oppose à une mobilité contrainte, comme celle des travailleurs obligés de se déplacer loin pour trouver un emploi stable. Ces réalités coexistent, mais seule la première est souvent per- çue comme un atout social.
Adrien Delespierre : C'est une question vaste. Mes recherches ont porté principalement sur les par- cours de formation, mais j'ai également suivi des cohortes d'anciens élèves, notamment des ingénieurs. Ce type d'expérience peut être perçu comme une accumulation de « capital international », pour reprendre un concept inspiré de la sociologie de Bourdieu. Ce capital inclut des ressources telles que des diplômes, des compétences linguistiques et des sa- voir-faire spécifiques acquis à l'étranger. Ces éléments peuvent être valorisés sur le marché du travail local ou international. Cependant, tout dépend de la nature et de la hiérarchie de ces capitaux. Par exemple, les diplômes des grandes universités américaines ou britanniques sont les plus valorisés mais aussi les plus coûteux, ce qui les rend souvent inaccessibles. Les stages ou les séjours de type Erasmus, plus accessibles quant à eux, ont un retour sur investissement moindre.
Il y a aussi une incertitude liée à la rentabilité de ce capital. Je prends pour exemple le témoignage d'une jeune femme qui avait appris le russe pour travailler dans le commerce entre la France et la Russie. Aujourd'hui, avec la crise géopolitique actuelle à cause de l'invasion de l'Ukraine puis la mise au ban de la Russie, cet investissement est large- ment dévalué. Ce « capital international » est donc soumis à une forme de volatilité, souvent dépendante des contextes économiques et politiques. C'est un peu comme à la bourse, où les différentes valeurs financières fluctuent les unes par rapport aux autres.
Les politiques publiques jouent également un rôle crucial dans la valorisation de ces capitaux. Par exemple, les programmes comme Erasmus permettent de réduire certaines barrières, mais leur accès reste limité pour des étudiants issus de milieux modestes, en raison de frais annexes ou du manque de sou- tien financier. En revanche, d'autres politiques, comme la hausse des frais d'inscription pour les étudiants non européens en France, compliquent l'accès à ces expériences, surtout pour les étudiants des pays francophones d'Afrique. Ces augmentations risquent de réduire la diversité des mobilités étudiantes et de concentrer les opportunités sur les seuls étudiants issus des pays riches.
Enfin, il est important de noter que les opportunités internationales ne sont pas perçues de la même manière selon les contextes nationaux. Dans certains pays, l'expérience internationale est un prérequis pour évoluer dans des secteurs économiques spécifiques, alors que dans d'autres, elle reste un avantage parmi d'autres. Cette disparité montre l'importance des politiques éducatives nationales et internationales pour structurer ces trajectoires.
Les trajectoires des diplômés démontrent également un rapport complexe avec les enjeux sociaux et économiques des pays d'accueil. Par exemple, un étudiant formé en France qui retourne dans son pays d'origine avec un diplôme reconnu internationalement peut voir sa carrière accélérée, mais cela dépend fortement des conditions locales et des réseaux professionnels établis.

Photo : Raissa Lara Lutolf Fasel / Unsplash
Adrien Delespierre
Ce type d'expérience peut être perçu comme une accumulation de « capital international », pour reprendre un concept inspiré de la sociologie de Bourdieu. Ce capital inclut des ressources telles que des diplômes, des compétences linguistiques et des savoir-faire spécifiques acquis à l'étranger. Ces éléments peuvent être valorisés sur le marché du travail local ou international.
Adrien Delespierre : Les écarts de genre sont significatifs, même parmi les populations sélectionnées comme les élèves des grandes écoles. Les femmes, bien que sur-sélectionnées pour accéder à des écoles prestigieuses comme Polytechnique, sont moins nombreuses à partir pour des masters à l'étranger. De plus, parmi les cadres expatriés, les femmes sont nettement sous-représentées dans les carrières les plus prestigieuses et les plus rémunératrices, comme la finance ou le conseil.
Les responsabilités domestiques jouent également un rôle clé. Dans les classes populaires, les jeunes femmes ont souvent des tâches familiales importantes, ce qui limite leur capacité à s'éloigner. Certaines étudiantes doivent régulièrement revenir chez elles pour aider une mère ou un proche malade, ce qui les contraint dans leur parcours académique ou professionnel.
Il existe aussi des attentes sociales contradictoires qui pèsent sur les jeunes femmes amenées à partir pour leurs études : d'un côté, la famille peut soutenir leurs projets, mais d'un autre, il y a une forte pression pour maintenir sur place des liens familiaux et sociaux. Ces forces de rappel sont moins présentes chez les hommes, perçus comme plus autonomes.
Plutôt que des dispositifs spécifiques supplémentaires car il en existe déjà de nombreux, qui ne résolvent pas ce problème de fond qu'est la précarité étudiante, il faudrait à mon avis repenser complètement le modèle de protection sociale des jeunes qui ne leur assure aucun revenu minimal avant l'âge de 25 ans. Il faudrait s'inspirer des pays qui mettent en place des bourses suffisamment élevées pour permettre à chaque jeune de vivre correctement et de mener ses études sans dépendre de ses parents, ni avoir à faire des petits boulots mal payés, chronophages et parfois nuisibles à sa santé.
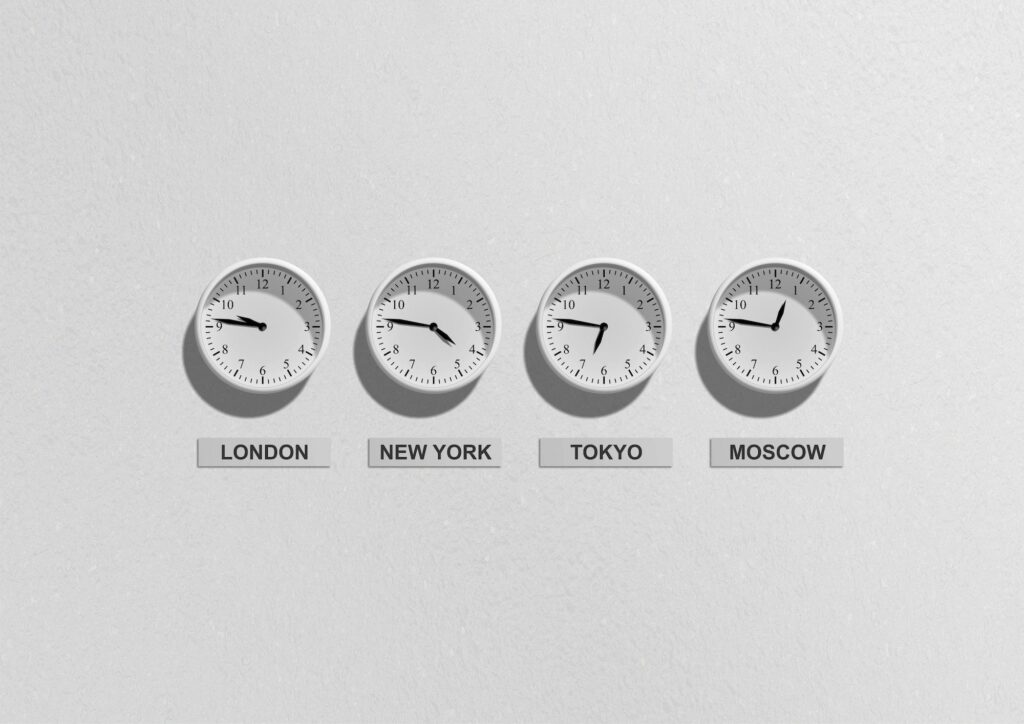
Photo : Pexels
Adrien Delespierre
Les écarts de genre sont significatifs, même parmi les populations sélectionnées comme les élèves des grandes écoles. Les femmes, bien que sur- sélectionnées pour accéder à des écoles prestigieuses comme Polytechnique, sont moins nombreuses à partir pour des masters à l'étranger […]
Adrien Delespierre : Dans les écoles d'ingénieurs, où les promotions sont plus petites et souvent composées d'étudiants issus des mêmes classes préparatoires, l'intégration des étudiants étrangers varie. Les Européens et les Maghrébins, surtout ceux ayant suivi une prépa en France, s'intègrent mieux. En revanche, les étudiants asiatiques, souvent moins à l'aise avec la langue ou les codes sociaux, restent plus isolés. Ces différences peuvent être accentuées par des stéréotypes ou des comportements racistes. Par exemple, les élèves asiatiques sont réputés pour consacrer beaucoup de temps au travail scolaire, ce qui est perçu très négativement par les élèves français sortis de prépa qui y voient la compensation d'un manque de « talent », et aussi par ailleurs un manque de virilité, dans le sens où cela renvoie à de la docilité à l'égard des professeurs et des exigences scolaires, dont doivent s'affranchir les hommes accomplis destinés à de- venir des dirigeants, des managers.
La dynamique sociale des promotions joue aussi un rôle. Les étudiants étrangers ont tendance à se lier avec des Français moins privilégiés ou ayant intégré l'école par des voies moins prestigieuses. Les élèves issus de grandes prépas parisiennes, qui maîtrisent les codes de l'élite, participent davantage aux activités associatives et aux réseaux de pouvoir, se tenant parfois à distance des étudiants étrangers.
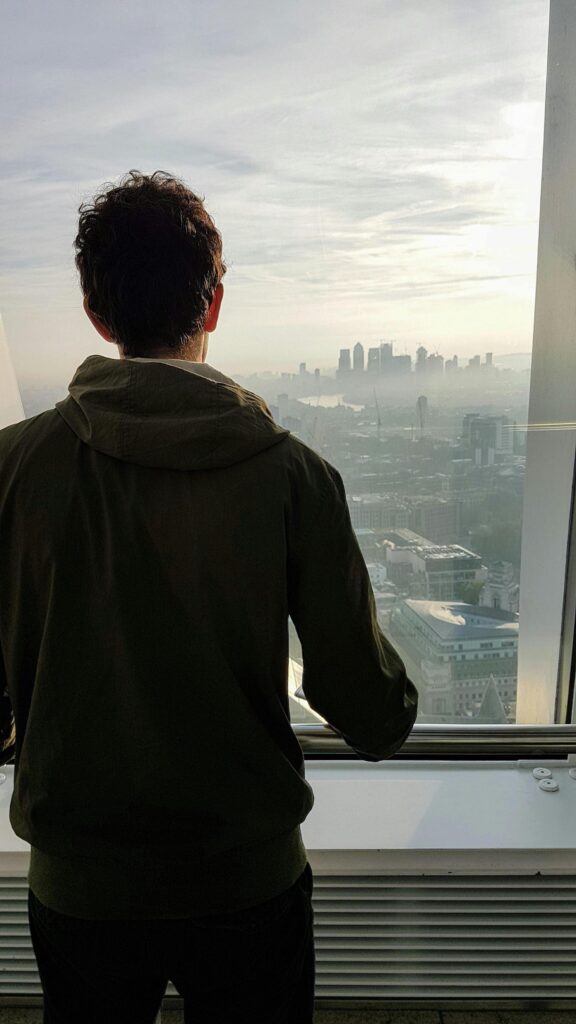
Adrien Delespierre : Leur impact dépend du prestige de l'école et du contexte. À Polytechnique, par exemple, l'institution elle-même n'oriente les élèves que vers des universités qu'elle estime suffisamment réputées. Aller dans une université jugée « non prestigieuse » serait très difficile. Pour les carrières, le réseau des anciens peut être précieux dans des contextes incertains, comme une expatriation en Asie, mais il est moins sollicité dans des environnements déjà bien établis pour les diplômés français, comme Londres.
Il est encore tôt pour mesurer pleinement l'impact du Covid. Indépendamment de cela, plusieurs tendances inquiétantes ont émergé. La hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers et la dégradation des conditions de vie étudiante limitent l'attractivité de la France. Cela touche particulièrement les étudiants francophones issus de pays économiquement défavorisés, qui apportent pourtant une richesse culturelle et académique indéniable.
Les étudiants étrangers, déjà confrontés à des barrières administratives et financières avant la pandémie, ont vu leurs difficultés s'accentuer. Les restrictions de voyage et la numérisation partielle des cours ont limité leur expérience, réduisant souvent leurs possibilités de tisser des liens sociaux et de mieux s'intégrer dans leur université.
La crise sanitaire a également mis en lumière les fragilités du système de protection sociale des jeunes. En France, cette protection repose encore beaucoup sur les familles, ce qui accroît les inégalités. Les étudiants issus de milieux modestes sont les premiers à en souffrir, et aucune réforme structurelle n'a été mise en place depuis le Covid pour remédier à ces problèmes.
Des politiques publiques spécifiques pourraient atténuer ces difficultés. Par exemple, investir dans des logements étudiants accessibles ou renforcer les aides financières – et pas seulement pour les plus précaires, parce qu'un droit qui n'est pas universel est vite remis en cause et présenté comme de la charité. Il faudrait que chaque étudiant (indépendamment des revenus de ses parents) bénéficie d'une bourse lui permettant pendant quelques années de vivre correctement en suivant sa formation. C'est tout à fait faisable, d'autres pays européens le font. La précarité étudiante n'est pas une fatalité, tout dépend des choix politiques qui sont faits.
CENTRAIDER est un réseau régional multi-acteurs, au service de toutes les structures engagées dans des projets de coopération décentralisée et/ou de solidarité internationale (collectivités territoriales, associations, établissements scolaires, hôpitaux, universités, etc.). CENTRAIDER s'est fixé pour objectif l'amélioration des pratiques des acteurs de la coopération et la solidarité internationale.
Siège social
Pôle Chartrain • 140, Faubourg Chartrain, 41100 Vendôme
Tél : 02 54 80 23 09
Bureaux
Le 360 • 78 rue des Halles, 37000 Tours
Tél : 06 42 59 76 32
CIJ • 48 rue du Bourdon Blanc, 45000 Orléans
Tél : 02 38 15 66 59
Espace Tivoli • 3 rue du Moulon, 18000 Bourges



