Publié le 10/06/2023

Photo : Max Bender / Unsplash

Entretien avec Pierre Micheletti, médecin, universitaire, et écrivain français. Spécialiste des questions humanitaires internationales, il travaille depuis près de trente ans dans l'humanitaire (Médecins du Monde, Action contre la faim) et a publié de nombreux ouvrages consacrés à ces sujets. Il est actuellement Président d’Action Contre la Faim.
Pierre Micheletti : Au milieu du XIXe siècle, Henry Dunant, un homme d'affaire suisse se retrouve, un peu par hasard, à assister à une bataille entre les armées française, autrichienne et italienne à Solférino. Ayant des convictions religieuses et humanistes, et devant ce carnage, il s'est dit que, malgré les logiques militaires de l'affrontement et du rapport de force que l'on retrouve sur un champ de bataille, l'on se doit aussi de traiter les blessés avec humanité. Comme ils sont neutralisés, ils ne sont plus des belligérants. Il défendait l'idée que des lois sont au-dessus des gouvernements et s'imposent pour humaniser la guerre. C'est la naissance d'un des premiers principes du droits international humanitaire qui est d'agir au principe d'une commune humanité auprès de populations peu importe leurs religions, leurs cultures ou leurs nationalités.
A la solidarité internationale, vielle comme le monde, présente notamment grâce à un substrat religieux, car toutes les religions sont porteuses de ces logiques, s'ajoute ainsi l'action dite humanitaire qu'on définit volontiers, au départ et dans sa version moderne, comme une volonté d'humaniser la guerre.
Le droit international humanitaire (DIH) se construit ensuite au fil des crises et des conflits par cercle concentrique : Le premier étant les prisonniers de guerre, puis les naufragés puis ensuite les populations civiles prises dans la tourmente de la guerre. En caricaturant un peu, l'on va passer au cours du XIXe siècle d'un droit qui concernait surtout les belligérants, les troupes, à un droit qui concernera plus les populations civiles.
Aujourd'hui, la conflictualité a évoluée notamment avec les groupes terroristes, comme Daesh par exemple, qui ne sont plus des acteurs clairement identifiables puisqu'ils s'immiscent dans les populations locales ou encore l'utilisation de nouvelles armes qui touchent à la fois les
armées et les populations civiles. Les batailles ne s'arrêtent plus à des frontières, le droit international humanitaire continue d'évoluer et fait face ainsi à d'autres problématiques qu'il faut suivre.
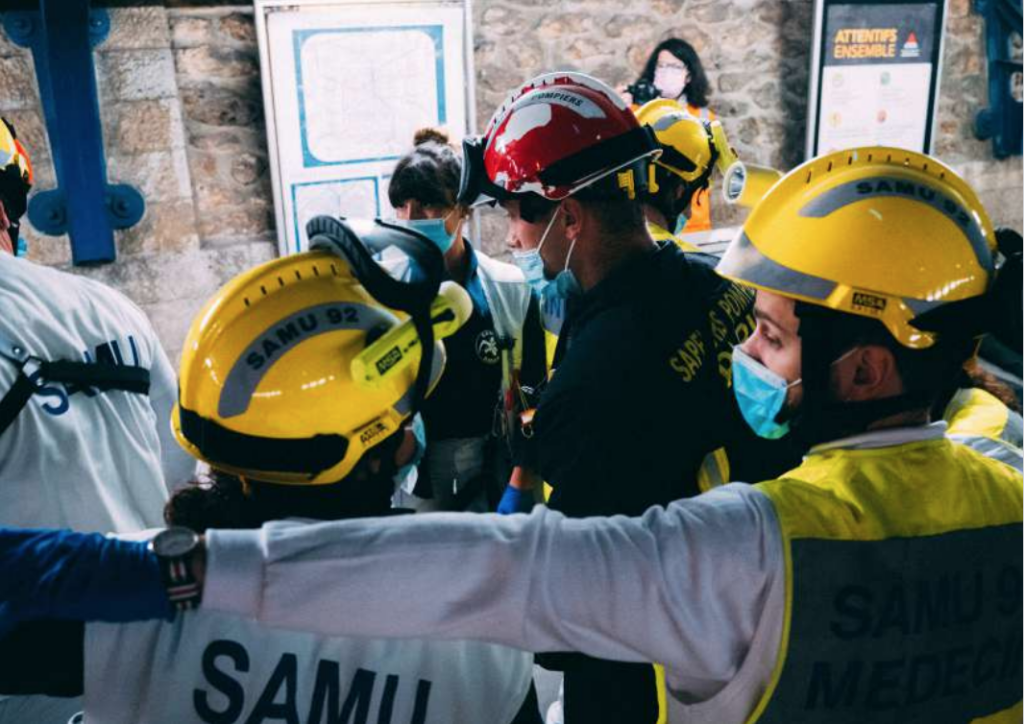
Photo : Mat Napo / Unsplash
Aujourd'hui, la conflictualité a évoluée notamment avec les groupes terroristes,
Pierre Micheletti
comme Daesh par exemple […]. Les batailles ne s'arrêtent plus à des frontières,
le droit international humanitaire continue d'évoluer et fait face
ainsi à d'autres problématiques qu'il faut suivre.
Pierre Micheletti : Par ordre « historique » il y a d'abord le CICR et son regroupement. Le mouvement de la Croix-Rouge agit depuis le milieu du XIXe siècle avant d'être rejoint au début du XXe siècle par les associations de solidarité internationale, rebaptisées dans les années 90 par le sigle ONG. Il y aura un essor particulier aussi au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour ce type d'acteurs et ils seront rejoints par la nouvelle Organisation des Nations unies. On pourrait rajouter une autre famille que sont les coopérations entre États.
Il existe d'ailleurs 5 éléments constituants pour une ONG :
En allant plus loin et pour reprendre la classification de la sociologue Édith Archambault, il existe ensuite plusieurs grands modèles d'ONG. En effet, les ONG internationales sont animées par différentes cultures politiques en fonction de leurs pays d'origine et entretiennent ainsi des rapports différents avec leur gouvernement.
Il existe donc un modèle anglo-saxon, un modèle méditerranéen et un modèle scandinave. Bien sûr, toutes les ONG d'un pays n'arborent pas forcément la même manière de penser, d'où le fait de les appeler « grands modèles ».
Par exemple en France, c'est plutôt un modèle dit méditerranéen. Dans notre pays, il existe une culture de la confrontation, au sens politique bien entendu, avec le gouvernement. C'est un processus d'interpellation du gouvernement pour faire bouger les lignes et non juste du conflit pour du conflit. Nous sommes dans de la co-construction politique. De grandes ONG françaises dénoncent par exemple le fait que la France ne remplit pas les objectifs de 0,7% du PIB pour l'aide publique au développement et interpelle ainsi le gouvernement.
Autre exemple, étant ancien Président de Médecins du Monde, nous avons constaté les méfaits de la toxicomanie dans les squats. Nous avons interpellé le gouvernement pour faire évoluer sa politique en termes de réduction des risques sanitaires avec comme solution la légalisation de la vente de seringue stérile.
Le délit de solidarité illustre bien la sociologie politique que nous rencontrons et la culture politique des ONG française. Il y a certaines associations qui, dans leur ADN, n'ont pas peur de créer les conditions de la confrontation avec les pouvoirs publics au nom d'un droit à agir et d'un devoir d'humanité au risque d'encourir des actions en justice qu'elles vont à l'encontre de lois. C'est le cas aujourd'hui pour les lois immigrations mais ce fût le cas aussi pour les premières associations et médecins du planning familial qui ont le pris le risque de pratiquer l'avortement avant la loi Veil. Ici, les soignants ont estimé qu'un certain nombre de jeunes femmes ont des grossesses non désirées, parfois dans des conditions dramatiques, et malgré que la loi, ils devaient franchirent cette barrière pour pratiquer certains actes au nom d'une déontologie universelle et humaniste. C'est exactement les mêmes logiques.
Le cas de SOS Méditerranée illustre aussi cette culture. Sans prise de position sur les questions migratoires, des marins et des soignants constatent des personnes exposées à un risque de naufrage et donc risque à leur vie lors de leur traversée. Au nom d'un principe d'humanité universelle, nous nous devons de porter secours soit comme marin, soit comme soignants aux embarcations en périls que nous croisons sur notre chemin. Ces positions et cette liberté d'association provoque aussi des réticences d'élus locaux, nationaux ou d'autres citoyens quand bien même elles se fondent sur des principes fondamentaux d'humanité.
Le modèle scandinave, quant à lui, suit d'autres logiques. Il y a une forme de coopération main dans la main entre les grands dirigeants des ONG et le Ministère des Affaires étrangères au sens noble bien évidemment sans une quelconque once de négatif. C'est l'histoire politique, la culture, la sociologie politique qui explique cette façon de faire.

Photo : Mat Napo / Unsplash
Aujourd'hui dans notre pays, il existe une culture de la confrontation,
Pierre Micheletti
au sens politique bien entendu, avec le gouvernement.
C'est un processus d'interpellation du gouvernement pour
faire bouger les lignes et non juste du conflit pour du conflit. Nous sommes dans de la coconstruction politique.
Pierre Micheletti : Oui. L'enveloppe annuelle, disponible pour répondre aux multiples crises humanitaires qui secouent la planète, est constituée de fonds gouvernementaux et de financements liés à la générosité de donateurs individuels.
Ces dons provenant des États restent largement prédominants, et proviennent d'un nombre restreint de pays et repose uniquement sur le principe de contributions volontaires.
En 2019, les États de l'Union européenne ont contribué à hauteur de 47% du volume annuel de l'aide humanitaire mondiale, en recul, depuis l'année d'avant, de 9%. Les principaux donateurs ont été les États-Unis, l'Allemagne, l'Union européenne, la Grande-Bretagne, les Émirats arabes unis et l'Arabie Saoudite. Ces deux derniers pays ont d'ailleurs largement augmenté leurs contributions depuis les dernières années notamment pour aider à la
résolution de conflits dans leur voisinage comme au Yémen. La France est 12e en valeur absolue.
En réalité, les financements de l'aide humanitaire sont l'apanage d'une petite vingtaine d'États voire d'une simple dizaine qui sont principalement des pays occidentaux…Comment empêcher un certain nombre d'observateurs politiques, animés ou non de bonnes intentions, de se dire que certains mouvements humanitaires ne participent pas à une forme de soft power de ces pays ? Il y a par exemple énormément de moyens humanitaires mis en place au Nigéria. Ce pays est pourtant un poids lourd démographique et économique, c'est aussi une puissance pétrolière et un pays important pour la « sécurisation » du Sahel. La question qui se pose dès lors c'est : Est-ce que les fonds alloués à la coopération ont toute leur place ? Sans arrière-pensées et correspondent-ils aux principes du droits international humanitaire ?
Dans ce cas-là on peut comprendre que les observateurs politiques qui émettent les hypothèses que les financements de coopération ne sont pas neutres de la part des
grandes puissance occidentales. Je prends l'exemple du Nigéria, mais c'est aussi le même cas à Haïti qui n'en finit pas de sombrer dans la misère, le cas également pour la République Démocratique du Congo… Cela pose des questions d'éthique et d'équité, en filigrane c'est montrer que les États considèrent que toutes les crises n'ont pas la même valeur.
Il faut donc repenser le système. En fait le financement de l'aide internationale humanitaire rencontre trois inconvénients majeurs aujourd'hui : Il n'arrive pas à réunir les sommes nécessaires pour couvrir les besoins identifiés chaque année par le Bureau de coordination des Nations unies pour les affaires humanitaires ; Il expose l'aide humanitaire à différentes formes de limitation ou de subordination à la volonté politique des quelques pays qui dominent largement, via leurs contributions volontaires, l'enveloppe annuelle; Il transfère aux principales ONG internationales les responsabilités de trouver des financements complémentaires à ceux des États. Il entraine, dès lors, ces ONG vers des formes de marchandisation de leur mission, vers une quête incessante de performance pour réduire leurs frais de fonctionnement, et vers une dépendance à l'égard de la générosité de leurs donateurs individuels. Sortir d'un système de financement volontaire, concentré sur un nombre très restreint de pays est désormais une priorité pour contourner ces obstacles. Le conflit en Ukraine le rappelle très bien d'ailleurs. Il y a une nécessité évidente de venir en aide aux populations mais cela détourne les regards des crises majeures ayant toujours lieues au Yémen ou en Haïti.
Sortir d'un système de financement volontaire, concentré sur un nombre très
Pierre Micheletti
restreint de pays est désormais une priorité pour contourner ces obstacles.

Photo : Mat Napo / Unsplash
Qu'en est-il aujourd'hui des ambitions initiales ?
Pierre Micheletti
De la volonté fondatrice, portée par des citoyens engagés,
de pouvoir porter secours en toutes circonstances ? en toute indépendance ? Cette capacité de déploiement est-elle universelle ? Intangible ? Poser ces questions établit l'idée que le doute existe, que les réponses ne vont pas de soi.
Pierre Micheletti : Le CICR a près de 150 ans, l'ONU 75 et les principales ONG humanitaires françaises ont entre 40 et 50 ans d'existence, quand leurs collègues britanniques, également
très actives (Care, Oxfam, Save the Children…), ont été créées entre la Première et la Seconde Guerre Mondiale. Qu'en est-il aujourd'hui des ambitions initiales ? De la volonté fondatrice, portée par des citoyens engagés, de pouvoir porter secours en toutes circonstances ? en toute indépendance ? Cette capacité de déploiement est-elle universelle ? Intangible ? Poser ces questions établit l'idée que le doute existe, que les réponses ne vont pas de soi.
Aujourd'hui, même si la valorisation reste forte, la perception de l'aventure humanitaire, et de ceux qui l'incarnent, ne se résume plus à une équation forcément positive. Les spectateurs de l'aventure humanitaire sont multiples : les populations confrontées à une crise, les responsables politiques, les combattants qui s'affrontent, les donateurs… Tous, différemment, observent et se questionnent.
Par exemple, les populations sur place ne font pas ou plus forcément la différence entre les armées issues d'un pays extérieur et les équipes humanitaires et c'est tout à fait compréhensible. Ils voient des ONG qui travaillent dans un pays où il existe une coalition internationale, et parfois travaille aussi avec l'armée. Dès lors les frontières s'estompent. C'est le cas en Afghanistan par exemple où parfois l'humanitaire est là pour « gagner les cœurs » des populations locales pour reprendre l'expression de l'armée britannique pendant la guerre de Malaisie lors de leur indépendance.
Et puis il y a des populations qui font très bien la différence mais qui considèrent que
cette différence est masquée. Que tout cela participe à une même logique avec une certaine suspicion à l'encontre des humanitaires.
Le contexte a résolument changé pour la sécurité des équipes. Je pense que l'une des nouvelles donnes de la violence sur le terrain à l'égard de l'humanitaire est d'ailleurs le narcotrafic. Vous avez beau être humanitaire si, en Colombie ou au Mexique, vous vous trouvez au mauvais endroit au mauvais moment et que vous êtes ainsi témoins de choses, votre immunité d'humanitaire n'existe plus et tout cela sans état d'âme.
Il faut que nous en prenions acte et que l'on recherche des stratégies pour sortir de cet étau qui contraint de plus en plus les différentes familles des ONG internationales.
Je peux reprendre ici une phrase de Régis Debray :Que peuvent les réalités contre les représentations ?

Photo : Shot Ed / Unsplash
Pierre Micheletti : Tout dépend le cadre dans lequel on se pose cette question. Les réponses sont différentes d'un territoire à un autre.
Comme je l'ai dit précédemment, la conflictualité d'aujourd'hui efface les frontières habituelles entre les forces dites régulières. Le terrorisme est une forme de conflictualité où les frontières sont poreuses avec la société civile. On n'identifie plus un belligérant par son uniforme. Le contexte d'intervention devient dès lors plus complexe.
Je dis complexe car les puissances occidentales notamment, sont prêtes à aider les populations civiles par conviction tout en sachant que c'est peut-être donner des moyens financiers à des personnes au sein des population qui peuvent être des acteurs terroristes ou favoriser des groupes terroristes. On comprend dès lors que ces grandes puissances sont très attentives sur cette question, d'autant que l'aide directe passe le plus souvent par des flux financiers. Ceci d'ailleurs évite toutes les problématiques liées à la logistique, aux transports ou encore au stockage même si cela conserve malheureusement un risque de détournement au profit d'acteurs de la violence.
Le compromis trouvé est de passer au tamis, par des logiciels spéciaux, l'ensemble des équipes et dirigeants d'ONG mais aussi nos fournisseurs pour éviter de financer, de manière indirecte, une personne ou une structure identifiée comme acteur de la violence. Ce raisonnement tend à aller plus
loin et à englober les familles des bénéficiaires des actions. Une partie de l'Agence Française de Développement défend cette idée par exemple et les ONG y résistent absolument.
Cette idée résulte notamment des menaces de sanctions américaines. Les conséquences seraient catastrophiques sur une banque française ou un organisme public venait à financer, indirectement évidemment, une quelconque forme de terrorisme. De même, si demain il devenait de notoriété publique que les ONG scannent les populations qu'elles aident, elles apparaitraient dès lors comme des acteurs qui aident des armées nationales ou internationales. Nous encourrions dès lors des risques majeurs pour la sécurité de nos équipes et bien sûr, cela engendrerait aussi une sorte de paralysie de l'action à tous les niveaux.
Non, un tel consensus ne doit pas être recherché à n'importe quel prix. Il faut à la fois négocier pour maintenir la paix, préserver la capacité d'agir pour porter secours, dénoncer les responsabilités de ceux qui s'opposent à l'acheminement de l'aide, et se donner les moyens de condamner les responsables de crimes de guerre. Face à ces écueils, la constellation humanitaire, au-delà de l'extrême diversité des organisations qui la composent, réaffirme en permanence ses postures fondamentales d'humanité, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance.
[…] la conflictualité d'aujourd'hui efface les frontières habituelles
Pierre Micheletti
entre les forces dites régulières.
Le terrorisme est une forme de conflictualité
où les frontières sont poreuses avec la société civile.
On n'identifie plus un belligérant par son uniforme.
Le contexte d'intervention devient dès lors plus complexe.

Photo : Mat Napo / Unsplash
Face à ces écueils, la constellation humanitaire,
Pierre Micheletti
[…] réaffirme en permanence ses postures fondamentales d'humanité,
de neutralité, d'impartialité et d'indépendance.
CENTRAIDER est un réseau régional multi-acteurs, au service de toutes les structures engagées dans des projets de coopération décentralisée et/ou de solidarité internationale (collectivités territoriales, associations, établissements scolaires, hôpitaux, universités, etc.). CENTRAIDER s'est fixé pour objectif l'amélioration des pratiques des acteurs de la coopération et la solidarité internationale.
Siège social
Pôle Chartrain • 140, Faubourg Chartrain, 41100 Vendôme
Tél : 02 54 80 23 09
Bureaux
Le 360 • 78 rue des Halles, 37000 Tours
Tél : 06 42 59 76 32
CIJ • 48 rue du Bourdon Blanc, 45000 Orléans
Tél : 02 38 15 66 59
Espace Tivoli • 3 rue du Moulon, 18000 Bourges


